"Mais au fond de
lui-même, il savait que lorsqu'on vous enlève une chose
dont dépend votre vie, il faut la remplacer par une autre,
tout aussi précieuse. Et cette autre chose précieuse se
développait en lui tel un fœtus dans les
ténèbres rassurantes de l'utérus." Hubert Selby
Jr LE DÉMON
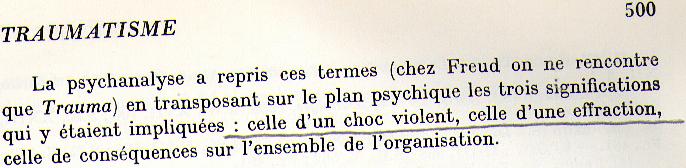
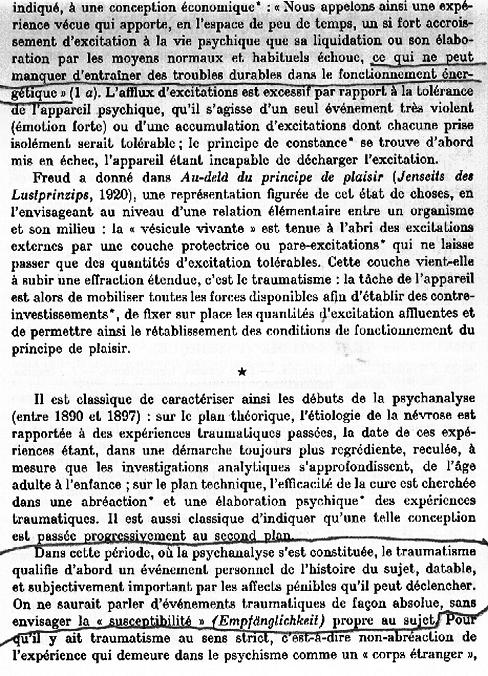 Trève
de
définition, j'ai quand-même tendance à penser
qu'il arrive à quasi tous (certains élus
échappent à la malédiction et coulent à
longueur de temps une vie douce) au moins un terrible accident qui
fait un trou dans la coque et force le navire à couler
jusqu'au fond.
Trève
de
définition, j'ai quand-même tendance à penser
qu'il arrive à quasi tous (certains élus
échappent à la malédiction et coulent à
longueur de temps une vie douce) au moins un terrible accident qui
fait un trou dans la coque et force le navire à couler
jusqu'au fond.
De
temps à autre je fais
surface mais me méfie terriblement de tout ce que je vois.
Les
traumatismes rendent les
hommes aussi peureux qu'un singe, la nuit dans sa caverne
préhistorique.
Jamais
dans aucun rêve
qui réitère la situation eschatologique de la perte de
l'être le plus cher au monde on ne réussira à
maîtriser la situation. Dans "Deuil et mélancolie",
Freud écrit: "En ce sens on a pu dire que le travail du deuil
consistait à "tuer le mort".
A
propos de ce reproche qu'on
me fait souvent de vouloir écarquiller les yeux des gens sur
une lucidité peut-être mortelle, je pense souvent
à Garcin, dans Huis Clos de Sartre que je vis pour la
première fois à la télé avec Michel
Auclair , qui dans leur enfer sans miroir et sans nuit, dit: - "Les
yeux ouverts. Pour toujours il fera grand jour dans mes yeux. Et dans
ma tête."
Alors
avec le Style (et la
pointe du stylet) je vais entrer pour retrouver le corps de la
mémoire (qui dirait le Texte), dans la chambre mortuaire TOUT
EN SACHANT que la mémoire ne sert à rien, pas plus que
la parole. Il n'y a que l'écriture que je puisse imaginer
être
la trace de l' Absent; l' écriture neutre de Duras, la voix
blanche dans les films de Bresson.
Pour
en finir avec cette histoire sans F
I N.
A
bien y
réfléchir cette aventure fut contre nature et banale si
je pense à tous ceux qui "vécurent" autant de
souffrance et pire encore. Cependant, à chaque fois qu'en
voiture je suis une ambulance, pare-choc contre pare-choc, je revis,
comme un mythe antique, cet horrible jour où, sur les genoux
de ma mère, devant (à la place du mort disent les gens
de la sécurité routière) avec notre meilleur ami
au volant, nous suivions à toute vitesse de peur de le perdre
de vue, le corps défunt, et pas malade comme tout le monde le
croyait, de mon père et de son mari, de son amour à
Elle.
J'ai
beau penser aux jeunes
enfants (je n'avais alors que mes douze ans) qui voient leurs parents
mourir sous leurs yeux dans les guerres imbéciles et d'autres
conneries qui tiennent toutes du livre des records du malheur, mes
larmes font encore pleurer le bon-dieu. Rien de plus triste que cette
perte si ce n'est celle de ce même homme pour sa femme et de ce
même éternel enfant (unique) pour sa mère. Ainsi,
quand le corps fut dans la salle à manger de ses parents,
transformée en chapelle ardente, il y avait, autour du
cercueil, réunis les trois plus grands malheurs du
monde.
Mes
plus grosses larmes je les
ai versées en serrant le cou d'un chien, seul avec lui sur le
balcon d'une maison bourgeoise qui donnait sur le jardin des plantes.
Derrière ma cataracte, je voyais à peine les arbres de
la terre. Un paon a chanté dans le parc et j'ai entendu hurler
les cerbères des enfers; mais je n'étais pas
Orphée. TOUT avait changé, je ne reconnaissais plus
rien et je voyais la mort partout. La peluche vivante léchait
mes joues salées et me disait: "c'est parce que je ne connais
pas votre mort que je t'aime. Dimanche j'irai à la chasse et
je te rapporterai le premier canard qui tombera du ciel; c'est bon
à manger." Je savais déjà avec mon petit
cœur qui battait à cent à l'heure que toute ma vie
je serai crucifié vif et que je crierai tout bas "Mon
père, pourquoi m'as-tu abandonné ? ".
Pourquoi
n'ai-je pas perdu la
mémoire des ces terribles journées? Pourquoi ces jours
ont-ils rempli toutes mes absences de réponse?
Pourquoi
suis-je devenu
l'absence incarnée.
"Vivez,
CECI est mon absence",
c'est ce qui devrait être gravé dans le marbre,
carré
58.
Rien ne comblera jamais
le trou béant que j'ai dans le coeur.
Personne
n'a jamais remis sur
ses essieux la charrette à l'envers.
Mais
avant la fuite du lieu du
"meurtre" (bien plus tard on m'a appris qu'il fallait absolument
passer par le rêve d'Œdipe) il avait fallu traverser la
nuit maudite, cette nuit que mon père n'avait pas
réussi à PASSER.Ce matin là, personne n'aurait
oser nous demander comment on avait passé la nuit. Je n'avais
pas
passé
la nuit du tout. Je resterai longtemps coincé dans la barque
sur les eaux noires et glacées et plus personne ne mettrait
jamais "des cales" à mes cauchemars, comme disait Michaux.
J'ai
beau chercher dans ma
mémoire je ne me souviens pas avoir jamais souhaité la
mort de mon père: peut-être ai-je manqué une
étape? "Papa, je t'aime fort, ne me quitte pas ..."
éternellement lancé dans la nuit et à la figure
des gens. Quand on a tout perdu on ne peut plus rien perdre d'autre
que soi-même ou que l'amour engendré. J'en étais
déjà là quand mes larmes dégoulinaient le
long du fer forgé. La fille de la maison (qui devait avoir
vingt cinq ou trente ans ... les années se perdent avec le
temps) s'occuperait de moi avec amour et compassion. Parfois,
j'entendais un: "ton papa est au ciel", et ce n'était pas fait
pour me rassurer, surtout qu'au "ciel" je n'y croyais guère
plus que mon père lui-même. Mais QUE DIRE à un
enfant, on ne va quand même pas lui parler de néant
alors qu'il n'est pas entré dans l' être.
Il
y a eu une fois, un "petit
père" de douze ans, un soir en robe de chambre après
dîner, dans une résidence encore en construction et dans
la boue d'Avril, autour de Tours, qui faisait la respiration
artificielle à un Dytique dans la baignoire de la salle de
bain à mi-chemin entre la chambre des parents et la chambre du
fils. Sans doute les dernières paroles que j'entendis de LUI,
furent-elles du genre "Allez, dépêche-toi! il est
l'heure d'aller au lit!". Si on avait su qu'il serait
assassiné par la mort cette nuit là, personne ne se
serait pressé à dormir, personne ne se serait
pressé à s'absenter l'un de l'autre; et ... qui sait ?
l'insecte aquatique aurait peut-être nagé plus
longtemps? Question à jamais, de plus en plus sans
réponse avec le temps: l'ai-je embrassé, avec mon coeur
avec mes petits bras, ce dernier soir pour lui dire "bonne nuit" en
même temps qu' À Dieu ?
Eternellement, les nuits
me prendront toujours
tout. Petit à
petit cette maudite nuit consacrée allait devenir mon mythe
rien qu'à moi. Eternellement, sans en connaître
l'origine, tous les jours et tout le temps, une ou deux larmes
réitéreront le gros chagrin. Je ne saurais plus dire
aujourd'hui, quelle heure il était exactement mais vu le
silence presque parfait et que le jour a mis tellement de temps
à se lever, il devait bien être 3h. "Il avait TROP
travaillé", m'a-t'on toujours répété pour
justifier indubitablement une disparition prématurée.
39 ans, moi qui le trouvais déjà vieux, c'était
la fleur de l'âge, celle que la mort préfère
cueillir. En plus de son travail, il préparait un concours et
nous avait même quitté plusieurs semaines, ma
mère et moi. Il prenait le train pour aller à Paris et
ne rentrait pas le soir: je ne comprenais pas bien. La distance, le
temps, la nécessité de travailler toujours plus;
à dix ans je n'y entendais rien. Je voyais les larmes tomber
des yeux de ma mère, je voyais la tristesse dans le regard de
mon père et puis je me consolais avec ce qu'on me disait. Et
donc il fut reçu plus jeune "inspecteur principal" et on avait
beau me dire que c'était "bien" comme à l'école
quand on me donnait un "bon-point", j'avais du mal à m'y
retrouver et admettre qu'il fallait qu'on quitte la ville natale et
ma chambre d'enfant qui donnait sur le pont-levis du château et
les canards qui chantaient tous les jours de pluie. Des amis
très riches, qui habitaient une très grande maison qui
donnait sur le jardin des plantes et jouxtait le lycée
où j'allais faire ma rentrée, allaient nous accueillir
et nous aider à trouver un logement. Cela tombait bien... lui,
le gros qui ressemblait à Jean Gabin, il était
"marchand de bien" (comment peut-on vendre du bien?) cet homme ne
peut être que gentil. Le problème, c'était que ce
qu'on devait habiter était encore inhabitable car pas fini de
construire. Alors en attendant on dormirait dans un meublé,
dans la grande banlieue de la ville. Le matin, je partais en bus avec
mon père et quand je descendais avant lui pour aller dans mon
affreux lycée j'étais déjà triste comme
si je pressentais la CASTASTROPHE à venir. "C'était pas
une vie", je le voyais bien. On avait beau dire sans arrêt que
les choses allaient s'arranger, j'avais l'intuition que ce
n'était pas évident. Monsieur Gabin avait un fils et
deux filles, tous trois de vingt ans, c'est du moins comme cela que
je m'y retrouvais (ils avaient vécu deux fois plus longtemps
que moi pour arriver à être des grands). La grande et
maigre blonde s'appelait Michèle et je n'avais jamais vu plus
belle. Le grand fils s'appelait Jean (un peu comme moi et comme
l'acteur auquel le père ressemblait) et habitait dans l'annexe
au fond du jardin (et là je touchais à la vie
parfaite). Quand mes parents avaient des choses importantes à
dire on m'envoyait avec Jean dans "ses appartements privés"
pour qu'il me fasse voir ses cages à insectes. Car Jean se
préparait à être vétérinaire.
J'avais bien compris que chez ces gens là on ne pouvait faire
qu'un métier important. Michèle faisait "son droit"
comme on disait et la petite brune rigolote, je ne sais plus, j'ai
oublié. Pourtant, en ce temps là, les femmes ne
travaillaient pas, et là j'avais du mal à comprendre
aussi: certes, ni ma mère ni la femme du "marchand de bien" ne
travaillaient au bureau mais ma grand-mère, Elle, elle
travaillait dur et on me répétait assez que, toute
petite, elle travaillait à l'usine. Mon dieu quel
mélange: et c'est cela qui vous fabrique un homme! Ainsi, nous
avions changé de vie en changeant de ville et avec la
promotion de mon père on changeait de classe sociale. Bref, on
était presque parvenu, sauf que le Destin et sa face de
démon allait venir gâcher la fête.
Jusque
là tout allait
bien: sauf que l'appartement de fonction dans lequel nous allions
nous installer était dans une résidence encore en
construction et que je devais marcher sur des planches au-dessus de
la boue des chantiers pour rentrer dans l'immeuble. Mais dans une
certaine mesure les enfants rient de tout et se rient de tout. Bref
il n'y avait rien de vraiment prêt pour nous accueillir et nous
allions devoir habiter en meublé pour quelque temps dans la
banlieue de la ville. Mon père travaillait comme un fou, ma
mère souffrait de solitude et de ne pas être dans ses
meubles et tous les matins il nous fallait une heure de bus pour nous
rendre en pleine nuit d'hiver dans le centre où se trouvait
mon tout nouveau lycée et son nouveau travail d' inspecteur
des PTT. Parfois son chauffeur venait le chercher et j'allais, triste
et seul à l'école.
A
posteriori, je me dis que mon
"papa" me manquait déjà.
Le
museau en l'air, je flairais
l'odeur de fin du monde.
Tout
ce dont je me souviens
c'est de dernières visites chez le médecin qui avaient
l'air d'être un peu alarmantes et le prévenaient
toujours d'un "surmenage". Trop de soucis, trop de travail, trop de
fatigue et la maladie sournoise dont je ne sus jamais le nom, vont
l'emporter dans quelques mois.
C'était
l'hiver et les
eaux de la rivière montaient en crue jusqu'au bas de la rue de
notre meublé, jusqu'à la porte du magasin de
pêcheurs, là où j'allais pour me distraire
acheter du fil et des bouchons pour pratiquer mon sport favori. Quand
on sortait de chez nous on voyait l'eau de la rivière qui
montait et montait toutes les nuits. Je me rendais bien compte que
mon père faisait tout ce qu'il pouvait pour rassurer ma
mère mais j'avais bien deviné qu'elle craiganit le
pire. Là-haut sur les hauteurs de la ville on allait
être bien. L'appartement serait tout neuf et les meubles que
nous avions dans l'autre ville allaient nous rejoindre. Au
lycée j'avais du mal à être à la hauteur
des espérances de mes parents. Tous ces changements me
perturbaient mais ce n'était rien à côté
de ce qui allait se passer.
C'est
vrai qu'il ne se passe
jamais rien. Pas d'épiphanie à l'horizon. Parfois il
arrive des choses...Il y a des gens qui meurent, on s'en remet
quand-même et puis on continue jusqu'au bout.
Et
donc la promenade du
dimanche consistait à passer voir où en étaient
les travaux et j'en profitais pour m'amuser à marcher sur les
planches que les ouvriers avaient montées sur des briques pour
faire des ponts sur les torrents de boues. En revenant, quand le ciel
était bleu et que ma mère s'enroulait dans son manteau
de renards, on regardait les grands remous de la Loire en se disant
que sur la colline on serait plus haut que l'eau et que là, au
moins, il n'y aurait jamais d'inondation comme en bas du
meublé.
Je
n'arrive pas vraiment
à me souvenir du déménagement car je crois que
j'avais été pris en charge par Pèpère et
Mèmère, comme je les appelais, les parents de ma maman.
Puis tout se brouille à nouveau dans l'antique mémoire
de cette horrible histoire de l'effondrement du monde. Dans le salon,
mon père s'était aménagé un cosi de
lecture avec une "barrière" en fer-forgé orné de
plantes, un fauteuil moderne-style ultra-confortable, un meuble-bar
qu'il avait dessiné lui-même, avec, posé dessus,
la toute neuve radio-pick-up et le tourne-disque Tepaz qu'il avait
ramené un soir à ma mère quand nous habitions
l'appartement dans l'autre ville, qui donnait sur le château de
Ducs. Jamais je n'ai bien compris qui étaient ces Ducs, pas
plus que, pourquoi il y avait deux Signes blancs et un noir dans les
eaux des douves.
A
nouveau, mes parents
pouvaient savourer Carmen et L'Arlésienne de Bizet qui avait
été leur premier 33tours 30centimètres. Les
78tours, c'était démodé m'avait expliqué
mon père le jour où on était allé
écouter dans un salon un des tous premiers 45tours.
C'était même pas encore de la Hi-Fi mais Dieu que ce
devait être beau à en croire le regard qu'il me faisait
en écoutant aussi "religieusement". Il m'avait même
appris à repérer là où c'était
bleu dans la Rapsodie de Gershwin. Enfin bref, tout était pour
le mieux dans le meilleur des mondes POSSIBLES. Mais vint le temps
des soucis et celui des visites chez le médecins. Le travail,
toujours le travail ... et les autres; les riches mais qui avaient
toujours l'air de ne rien faire. Le père, un soir il nous
avait fait rentrer dans son bureau pour boir un appéritif et
le regarder fumer son gros cigare (je n'en avais jamais vu d'aussi
énorme). Il était satisfait de lui car il avait vendu
un bel immeuble. Franchement un monsieur qui vendait des "biens" ce
ne pouvait être que quelqu'un de bien. De fait je comprenais
dans ma petite tête que cette famille était la
providence pour mes parents si seuls dans cette ville
étrangère.
Quand
nous entrâmes dans
le mois d'Avril mon père entreprit de se faire un bureau dans
ce qui normalement était un salon. Ma mère avait cousu
des double-rideaux et il ne restait plus qu'à scier des
planches et à les peindre pour masquer la tringle. Cela allait
lui prendre l'éternité. De telle sorte que cela devint
un mythe, pour moi seul. Quand je suis forcé par le manque de
temps, à laisser un travail, une œuvre, inachevé
alors qu'il faut dormir, cette idée est, au sens propre,
"in-supportable". Ajouter à cela, que par un mauvais hasard,
ma mère, l'avait pris en photo la veille, résolvant des
équations en vue d'un nouveau concours. Ainsi, elle ne savait
pas qu'en faisant la dernière photographie ce serait aussi, la
nuit passée, devenu l'ULTIME, celle après laquelle il
n'y en aurait plus jamais d'autre possible, faute de CORPS. C'est
comme le lendemain où, devant moi, elle sortit de la penderie
du mort, un costume de cérémonie, en croyant bon
d'ajouter: "Ce costume, il avait dit qu'il ne le remettrait que le
jour de son enterrement". Terrible et tragique PERE, qui lui avait
fait un soir la mauvaise plaisanterie d'avoir l'être
d'être mort: quand ma "maman" avec moi, s'est mise à
pleurer, il rouvrit les yeux et dit: "c'était pour voir
comment tu ferais, si j'étais mort". Ce mot, là, cette
chose "sans nom", il la fit 5 ou 6 ans avant, ne sachant pas que
j'étais LÀ. Nous fûmes rassurés et je
compris BIEN que ce n'était pas grave, et que seul un
ARRÊT DE MORT, signé plus tard par le maître du
temps, serait le seul à valider la très mauvaise
plaisanterie, l'Innomable, faite par un être plus
désespéré qu'on ne me le fit jamais croire. Plus
tard, des dizaines d'années après, on m'apprit qu'on ne
plaisantait pas avec cette CHOSE là: qu'il y avait une
différence (une pertinence, me dira encore plus tard mon
très grand professeur de philosophie) entre le GRAVE et le
SERIEUX.C'est bien ce que je
pense encore,
en regardant sur mon mur la même GRADIVA, au pied léger,
que Freud contemplait tous les jours en écrivant.
Post tenebrae fiat lux.
MAIS
CE qu'il ne savait pas,
en nous jouant ce tour de VILAIN, cette méchante farce
tragico-comique,c'était que j'aurai toute la vie durant, la
facheuse habitude de prendre ce GESTE, pour PAROLE d'évangile.
Alors,
après une
journée ordinaire, ils passèrent la soirée sans
bruit, tandisque je m'échinais à RANIMER un Dytique
(Coléoptère aquatique) que m'avait donné en
cadeau, le grand fils de la famille "Gabin", celui qui faisait ses
études de vétérinaire. Enfant de 11 ans, je me
retrouvais la veille au soir de la mort de Père, à
essayer, EN VAIN (mais comment pouvais-je alors le savoir?) de
redonner vie à un insecte déjà mort en lui
pratiquant dans l'eau du bidet, la respiration artificielle (comme
quelques heures plus tard le médecin de famille à
cheval sur le corps perdu du "pater"). Avec des petites mains
d'enfant, j'enfonçais régulièrement de mes deux
pouces, le thorax de la pauvre bête, qui sans doute, pas
complètement "crevée" se mettait à nager
VAGUEMENT. Puis, j'entendis de la chambre des parents, la voix de mon
père, qui cria: "Maintenant, il est tard! demain il y a
lycée." Non, il n'y aurait pas classe et cela pendant plus
d'un mois.
Je
ne me souviendrai jamais, et
personne ne me le prouvera jamais, que j'ai embrassé mon
père ce MAUDIT soir. Et si c'était un soir où
j'étais allé au lit, furieux contre LUI, sans
même lui faire un bisou? Même qu'il était
rentré, furieux, dans la salle de bain et avait vidé
l'eau d'un trait. On avait mis l'insecte dans une soucoupe de
porcelaine blanche et il m'avait consolé en me disant qu'il
allait s'en remettre. L'insecte est toujours perforé de
l'aiguille dans la boite exposée au mur. Le corps du
Père moins bien conservé que celui du
coléoptère est toujours couché dans sa
boite.
Dans
le salon, il y avait des
planches toute fraiches peintes pour recevoir des rideaux qui ne
seraient jamais posés. Un travail jamais terminé.
Pénélope ne tissait pas et ne détramait pas
n'importe quelle toile. C'était celle d'un linceul. Elle
attendait le retour du sage Ulysse et mettait du même coup la
mort en attente. Tous les moyens sont bons pour suspendre le temps.
Mais le geste avait beau être réitéré, le
temps continuait à passer. Le pire c'est que cela sentait bon
la peinture. Les feuilles pleines d'équations
algèbriques avaient été rangées dans le
tiroir du bureau, certaines allaient attendre pendant
l'éternité leur
résolution.
Le point
final n'existe
pas
La
nuit maudite où
j'apprenais (des années et des années avant l'âge
normal - celui auquel on perd le premier être chèr,
généralement un grand-père) que la vie avait une
F I N ,
je comprenais aussi que
j'en serai toujours "absenté". Un jour, une nuit, je mourrai
MALGRÉ
MOI
, car comment
pouvait-on vouloir une chose pareille (du haut de mes douze ans, je
ne savais encore qu'on pouvait mourir volontairement).
Lui
Monsieur mon
Père, il voulait que sa peinture sèche et finir de
résoudre ses équations pour mieux vivre avec sa femme
et son enfant (c'est du moins, ce que j'imaginais qu'il
pensait).
Monsieur
IL, voulait que cela
ne finisse pas, autant que cet après-midi, quand il
était venu me rechercher à la F I N du premier film
où j'étais resté seul dans la salle de
cinéma à "mirer"
VOYAGE AU CENTRE
DE LA
TERRE: je le
tirais par
la main pour le forcer à regarder le générique
pour mieux faire durer le moment d'après qui est encore du
cinéma.

Je
regrette fort qu'on ne voit
pratiquement plus jamais le mot
F I
N
SUR LES ÉCRANS.
Ce n'est certes pas par
pudeur qu'on a supprimé ce mot mais bel et bien par
auto-censure. Sans doute la finitude va t'elle à l'encontre du
capitalisme? Non seulement les films n'ont plus de fin mais ils
peuvent être recommencés at home en DVD, ou
continués par les auteurs qui leur font des suites douteuses:
REMAKE SUITE RETOUR et autres RELOADED.
Mais
ce soir là mon plus
beau film s'arrêta et quelques jours plus tard la vie de mon
père avec. Nous sommes restés, moi, ma petite main dans
la sienne, à regarder le générique.
L'écran est redevenu blanc un instant avant que le rideau
rouge ne se referme. "Tu vois, maintenant c'est fini" la salle s'est
rallumée...et désormais cela F I N ira sans cesser:
c'est devenu ma RITOURNELLE....
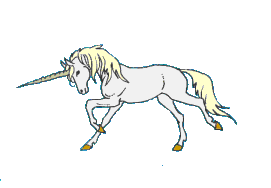
La
plainte des agonisants lovés sur leur couche rejoint les
vagissements des nouveaux-nés gesticulants comme des cafards
retournés sur le
dos.-
Petit
prince à sa
façon réitère la situation. Il veut toujours
écouter la chanson du générique de la fin du
dessin animé et du même coup regarde passer comme des
pictogrammes les noms des génériques. Quand on est
enfant on croit vraiment que le cinéma c'est la vie: les
gosses, on peut leur faire avaler n'importe quoi, c'est comme le
mariage, pour le meilleur et pour le pire. Et puis les enfants
d'aujourd'hui avec le SURROUND DIGITAL 5.1, dans leur fauteuil, ils
ont les fesses qui tremblent et leurs enfants à eux avec le
relief ils attrapperont les dragons par la queue comme on claque une
mouche.
"On
s'y croirait".
Comme
quand Petit Prince, 42
années plus tard regarde le SACRÉ DYTIQUE dans la boite
à insectes acrrochée au mur tel un dessin de Saturnin
FABRE , ou les merveilleux papillons collectionnés par
"L'OBSÉDÉ" qui gardaient toute leur beauté,
contrairement aux femmes qui fondaient en cendres carboniques
après la mort.
CE
N'EST PLUS LA
RÉALITÉ, ce n'est que de la VIRTUALITE,
C'EST
LA MORT EN
MOUVEMENT.
Un coup de fil ,
comme
on dit encore stupidement aujourd'hui, une sonnerie musicale de
portable à me percer les tympans, alors que je suis seul avec
Petit Prince à le faire manger (V... est au lycée, elle
ne rentrera pas avant 21h.)
Un
policier, puis un
médecin me confirment la
mort soudaine de ma mère.
1961
__________________________________________________ 2003
Comme l'avait fait ma mère, j'ai ouvert tous ses
tiroirs
et
ses penderies si
maniaquement rangées pour lui trouver son costume pour voyager
dans l'éternité.
Pour
en revenir au fait,
Monsieur l'Inspecteur: ma mère avait porté son choix
sur un costume que papa avait décidé de ne remettre que
pour son enterrement! Avouez, elle aurait pu lui en trouver un qu'il
aimait.
Alors
maintenant le v'là
qui erre dans la nuit des temps avec un costume qu'il
détestait. Et puis quand on n'a plus que les os sans la peau
il n'a plus un seul costume qui tombe bien. Hors, de son vivant il se
faisait tailler tous ses costumes, chez le tailleur qui était
aussi le commerce du rez-de-chaussée de l'immeuble. Quand
Monsieur Beccavin sortait ses grands ciseaux et qu'il mettait son
mètre ruban autour de son cou, je devinais que j'allais
m'ennuyer un peu, alors je regardais le Pont-Levis du château
de la Duchesse Anne.
DONC,
il restait les planches
enduites d'une première couche de peinture grise posées
en travers de son bureau sur un monceau de feuilles remplies de
calculs algébriques pour protéger ce qui était
avant la table de la salle à manger. Mais le changement de
classe sociale (appartement de fonction, à la
périphérie certes, non achevé et en plein dans
la boue, et chauffeur en 404 Peugeot noire, mon mère en
était encore à la 203 grise.) laissait présager
un petit bureau ministre et une grande et ronde table du XVIIIeme (ma
mère aimait déjà fureter chez les antiquaire,
qui, aux dires de Monsieur Gabin étaient les plus belles
vitrines de Tours, dont je ne connaissais encore que la monumentale
bibliothèque municipale -Maison Blanche en miniature- les
fontaines de la place Grammont, et mon horrible Lycée
Descartes à l'entrée duquel je pleurais
déjà quand je voyais mon père s'éloigner
vers la Grande Poste à quelques centaines de mètres.
Nous
les Humains, qui n'avons
aucun sens sur-développé, pourquoi n'aurions-nous pas
dans l'arrière boutique de notre conscience (la
lucidité des dépressifs, la clairvoyance des fous, la
prémonition des obscédés...) le pressentiment de
la mort prochaine.
Jadis dans les
campagnes, on l'entendait venir de loin la charrette de l'Ankou.
Je
lui envoyais des bisous
volants que je tirais de la paume de ma main, mais pas trop, car les
petits cons se moquaient de moi. Et le soir à la maison,
j'attendais comme
3
ans avant, ce moment magique, cette épiphanie sonore où
le vent des trompettes venait à bout de toutes les
fortifications qui nous séparaient LUI de MOI, Où ses
clefs cliquetaient dans la serrure quand Monsieur IL entrait et
m'embrassait, LUI , sans qui, quelques nuits plus tard, je
redeviendrai R I E N,
NADA !
Pour
ce qui était de l'appartement de fonction, visiblement les PTT
s'étaient payé sa tête (si j'ose dire). S'ils
n'étaient pas partis en Afrique c'était à cause
de la mauvaise santé cardiaque de ma mère, et Tours la
bonne vieille cité bourgeoise des bords de Loire
c'était encore du domaine du possible. Mais quitter
l'appartement du quatrième étage, plein centre, avec
vue sur le château des Ducs pour atterrir dans une
résidence noyée sous la boue d'hiver et les
tracto-pelles, c'était pousser le bouchon un peu loin. Ce que
voyait mon père c'est qu'il lui faudrait du temps pour aller
à la Recette Principale le matin mais qu'heureusement il
pourrait parfois me déposer au Lycée. Quant à ma
mère elle était furieuse de ne pas avoir eu un
apprtement de fonction dans le centre, style vieil immeuble
dix-huitième en tuf blanc.
Bref,
cette nouvelle vie
ne satisfaisait personne mais nous aurions dû la trouver BELLE,
car la VIE est belle et que quatre mois plus tard, juste avant la
pendaison de crémaillère elle allait nettement devenir
très moche.
Mon père était
très fatigué et allait parfois chez le médecin
(c'est tout ce que je savais) et cela restera à tout jamais le
seul intersigne.
Ma mère avait toujours
l'air triste et déprimée (elle ne travaillait pas) car
elle avait perdu tous ses amis nantais (dans les années 60
l'espace kilométrique n'avait pas encore été
absorbé par la Grande Vitesse) et n'avait toujours pas
récupéré tous ses meubles
Moi, je tristais de profs en
profs et ne réussissais pas à me faire un
ami.
C'était un lycée
de super-zozos de luxe, mais de zozos
quand-même.
Quand je rentrais à
l'appartement je faisais le funambule sur les planches posées
sur des briques.
-
Jean le fils
vétérinaire de Monsieur Gabin m'avait appris à
capturer des insectes et à les faire vivre dans des vivariums
que je fabriquais moi-même. Ma mère autorisait et mon
père m'aidait.
-
Quant à la grande et
blonde sœur Michèle toujours en tailleurs verts (je ne
revis une telle figure que six ans plus tard chez les
héroïnes des films d'Hitckock) j'en étais de plus
en plus amoureux, même si mon sexe n'avait jamais montré
la moindre érection.Mais moi 11 ans et elle 30, j'avais bien
conscience de la différence vertigineuse.
Pourtant
il m'avait bien
semblé que dans le célèbre film d'alors "LES
DIMANCHES DE VILLE D'AVRAY", le soldat devait avoir la trentaine et
la petite fille la dizaine.
Jour
après jour ma
mère agençait son intérieur et cela la faisait
sourire.
Quand
le chauffeur en
livrée venait chercher mon père il lui payait un jus
avant de prendre la route pour faire la tournée des
inspections et je comprenais bien que ma mère était
fière (elle dont les parents n'avaient jamais
été que des ouvriers). C'est vrai que la casquette et
les gants blancs cela en imposait.
Un
dimanche après-midi
papa quitta ses livres d'algèbre (car il créait un
service à la toute neuve centrale nucléaire) pour
s'installer sur la table de bridge pour dessiner deux petits balcons
en fer forgé pour que ma mère puisse y mettre des pots
de fleurs. Alors avec le meuble qu'il avait lui-même
dessiné et fait faire par un facteur syndicaliste et le
fauteuil de lecture nouveau style qu'il venait d'acheter, il se
ferait un petit espace cosi pour lire en écoutant de la
musique sur le nouveau Tépaz.
Maman
cousait
déjà les doubles rideaux qui ne seraient jamais
accrochés.
*
A bien y
réfléchir, à cette époque de ma vie
(comme on parlait d'époque dans les feuilletons de
littérature populaire) je ne savais rien de la mort, ni
même que j'étais mortel. Petit Prince 4ans en sait
déjà plus long: il sait qu'il ne verra plus sa
grand-mère (ma mère) pour "JAMAIS" car avec "TOUJOURS",
ce sont deux nausées qui l'ont encore épargné et
qu'elle ne sera pas là dans trois mois pour accueillir le
dernier Père Noël de sa vie. Même qu'un soir il a
dit : "On la verra plus , c'est dommage" ,
comme
dans la chanson de
Brigitte Fontaine jeune "Dommage que tu sois mort". Mourir ça
m'embête.
La
maladie, l'absence de ma
mère pour cause de fièvre et d'hôpital, cela je
connaissais. Et puis PARADOXALEMENT, mon meilleur ami de vacances
chez mes grands-parents, SON PERE ETAIT MORT, et mon nouvel ami (que
je me fabriquais tant bien que mal dans notre New York) SON PERE
ETAIT MORT AUSSI. Celui des vacances me projetait les vieux films en
9mm/5 que faisait son père; celui de Tours me montrait parfois
des photos. Nous faisions partie d'une communauté inavouable
et n'en parlions à personne. lui! il est orphelin, avait
lancé un professeur : "Non, moi ma maman ell est vivante"
avais-je répondu.
Les
ouvriers avaient
commencé à déverser des gravillons, à
peindre les rampes d'escalier. L'hiver était froid mais le
chauffage collectif marchait bien.
Le
rêve de ma mère
était de paufiner l'intérieur pour pouvoir inviter
dignement Monsieur Gabin, Jean le véto et Michèle mon
amoureuse de trente ans.
Enfin,
un dimanche,
c'était véritablement le seul jour où mon
père se donnait du temps pou fabriquer son salon "cosi", les
barrières en S
étaient
installées, le fauteuil avait été livré,
le meuble dessiné par lui installé avec dessus la radio
pick-up. Maman avait choisi et disposé quatre plantes à
fleurs qui parachevait ainsi ce "petit coin de verdure", de luxe et
de calme.
Le
grand soir arriva où
il put enfin s'asseoir, écouter les Nocturnes de Chopin,
allumer sa seule et unique pipe, savourer un muscat et lire Paul
Valéry. =
Sincèrement,
Monsieur
l'Inspecteur je ne pourrais pas vous dire s'il a eu le temps d'avoir
ce plaisir 3 ou 6 fois, mais je serais tenté d'opter pour 3 au
grand maximum.
La
semaine qui suivit la
première séance du salon de musique et de lecture, mon
père est rentré très tard un soir, très
fatigué, très triste et déçu par un
papier qu'il montrait à ma mère: JE N'EN SUS JAMAIS
PLUS LONG. Ma mère me confirma qu'il ne s'agissait
QUE DE
RESULTATS
d' analyses d'une
prise de sang et tuti allait bene.
Pas
d'arrêt de
travail (cette expression me fait toujours penser à cette
émission théâtrale que mes parents
écoutaient avec passion sur Paris-Inter dans les années
1958 - ART ET TRAVAIL - et moi qui n'avait le droit d'écouter
que l'indicatif j'entendais "arrêt travail" et mettais
toujhours plus ou moins cela avec tous les problèmes qui
tournaient autour des grèves dont mon père avait l'air
d'être un meneur) donc c'était bon signe. A cette
époque quand on était malade on gardait la chambre
(là aussi je me laissais à penser que c'était la
chambre qui nous gardait).
Le
lundi matin, bien avant que
je parte au lycée (et je devrais y aller en autocar alors
qu'il faisait encore nuit) le chauffeur est venu chercher mon
père quand je prenais encore mon bol de chocolat.
"ce
soir j'irai t'embrasser dans ton
lit."
Quand
il est rentré je
ne dormais pas encore mais je voyais bien qu'il avait l'air
fatigué, mais ce n'était pas le mot exact, et je
m'endormis en cherchant le mot juste comme on le faisait aux cours de
vocabulaire avec le seul prof que j'adorais; Monsieur Girolle
professeur de Français. Epuisé, exténué,
harassé, au bout du rouleau, vanné... puis j'ai
trouvé le mot et me suis endormi dessus avec des larmes qui
sourdaient: LAS.
Le
mardi matin c'es lui qui me
conduisait au lycée, c'était à mourir tellement
tout était triste, mes notes étaient mauvaises, le vent
sifflait entres barres d'immeubles; Saint-Cyr en Bourg était
vraiment très laide.Quand nous sommes partis ma mère
dormait encore, elle avait une longue journée
d'aménagement de l'appartement, de visite à l'heure du
Thé chez les Gabins, puis de
lèche-vitrines.
Le
soir mon cours finissait
à cinq heure et pour la première fois j'avais obtenu le
droit d'aller retrouver mon père dans son grand bureau de
Tours RP. Le bâtiment qui était une horreur de la
reconstruction m'impressionnait tout de même par sa hauteur. La
secrétaire de mon père (une martienne par rapport
à ce CE QU'ON NOMME SECRÉTAIRE AUJOURD'HUI) me prenait
sur ses genoux, malgré mes onze ans et me faisait taper fort
sur sa machine à écrire pour que cela noircisse bien la
papier carbonne qu'elle me glissait dans une enveloppe comme un
merveilleux cadeau. Papa rentrait dans le bureau et le bonheur lui
tenait le bras.
Décidément
ce fut
une belle soirée: comme j'avais eu un 18 en vocabulaire mon
mon père me prit par la main et me me chucuta à
l'oreille "on va laeer acheter un disuqe de muisque pour toi: tu
choisiras ce que tu voudras".
Ce
fut la musique du cirque de
Moscou. J'avais un peu peur qu'il ne fut pas d'accord, mais il
accepta avec plaisir. De la vraie musique de cirque comme on n'en
jouait plus même en France. L'URSS brillait encore de tous ses
feux même si c'était l'Etat qui prenait les artistes en
charge et les "contrôlait" ce que j'ignorais de toute mon
innocence enfantine. Enfin pas complètement car
Pèpère Communiste et Franc-maçon m'avait assez
vanté les Grandes Ecoles de Danse Russes et les films d'
Eisenstein; "Le cuirassé Potemkine, Octobre, Alexandre Newski"
et forcément les plus belles voix du monde c'était pas
"Les petits chanteurs à la croix de bois" mais "Les
chœurs de l'Armée Rouge". Je comprenais bien qu'il
n'avait pas eu beaucoup d'affection pour Staline mais ceux qui
savaient se taisaient et peut-être que lui Marcel ouvrier
à l'EDF, il ignorait tout des camps.
Et
en cette année 1961
le cirque de Moscou était plus brillant encore que Bouglionne,
Pinder, Amar et Médrano; la Chine était
quasi-médiévale.
Le
disque noir 33 tours
microsillons, stéréo, gravure universelle, sous le bras
nous entrâmes dans un salon d'écoute avec grands
Haut-parleurs, divan profond, moquette épaisse et cendrier en
cuivre sur pied, sans conter la vendeuse plus belle qu'une
hôtesse de l'air. Les extraits qu'elle nous fit écouter
me faisaient sauter de joie et trépigner de plaisir. De plus
le Monsieur Loyal parlait en russe et c'était le comble du
bonheur.
Ainsi
en rentrant à
l'appartement on ouvrit un Champagne et j'eus l'autorisation
exceptionnelle de rentrer dans le coin musique. Ma mère assise
sur son fauteuil-bridge préféré, moi par terre
en tailleur sur le tapis "art-nouveau" on applaudissait
synchroniquement avec les spectateurs russes car c'était un
enregistrement en direct. Ma mère retrouvait un peu son sourir
et mon père se décrispait.
Un
ange passait qui sans doute ne
savait pas lui-même qu'il était suivi par une horde de
démons 
Et
désormais ces
démons resteront accrochés à mes basques comme
des chauves-souris dans les cheveux. Quelques jours plus tard ils me
firent faire une photo fiers qu'ils étaient d'en avoir
terminé avec la noirceur des derniers temps.
Et pourtant... ce nouveau
bureau qui était le lieu d'un riche avenir était (en
vrai) la salle d'attente de l'exécution capitale à coup
d'infarctus du myocarde par le sale destin. Et toujours cette
éternelle rengaine (les médecins me reservront la
même à la mort de ma mère) "Il n'a pas souffert
... il est mort pendant son sommeil". Mais quel enfant peut croire
que la mort ne fait pas souffrir et que mourir quand on dort ne
réveille pas ?
On
devrait toujours faire
très attention aux mensonges qu'on dit aux enfants, surtout
dans les catastrophes. En
cas contraire on se retrouve avec des adultes qui ne croient plus
personne.
Autour
du vin des côteaux
tourengeaux, la vie avait l'air l'aire presque belle.
Mais
dès le lendemain,
le maudit hiver venait à nouveau frapper à la porte
comme dans la cinquième de Beethoven. La pluie faisait couler
la boue dans l'éternel chantier de notre nouvelle
résidence. Certains jours, profitant des minuscules
éclaircies, ma mère se faufilait en ville pour tisser
des liens avec les nouveaux amis. Le chauffeur passait prendre mon
père à la maison qui pouvait laisser la 203 toute neuve
dans le parking. Le riche avenir nous tendait les bras et nous
n'étions que ses Tantale sans le savoir. Elle achetait des
tissus imprimés à larges fleurs de tapisserie pour
coudre elle-même (puisque mère au foyer) des
double-rideaux que mon père accrocherait après ses
devoirs d'algèbre. Aujourd'hui elle finissait de ranger la
penderie dans le bureau et d'y accrocher un costume noir à
propos duquel "papa" avait di: "De
toute façon celui la, je ne le remettrai que pour mon
enterrement".......................................
Il paraît qu'il n'avait pas le droit de dire Cela. De fait, je
pourrais dire comme certains intellectuels que je connais bien "Moi,
la mort cela ne me regarde pas!"
-
Non, jamais je ne pourrai car
la MORT une nuit m'a regardé droit dans les yeux et m'a
chuchoté à l'oreille "Je t'ai à l'œil petit
garçon" .
.
Ce
n'était pas normal
que mon père se rende chez le médecin trois fois de
suite, il n'était jamais malade (du moins c'est ce qu'on
raconte aux enfants) et s'en revienne sans ordonnance. Mais il
travaillait sans cesser et était parfois très
fatigué mais toujours si doux avec moi. J'étais devenu
grand avec mes onze ans mais j'étais toujours fou de joie
quand j'entendais ses clés dans la serrure comme du temps
où je me suspendais à la poignée de la porte
pour regarder par le trou de serrure si je le voyais monter les
escaliers.
Une
vénération,
je vous dit.
Tout
le malheur et toute les
maladies graves de ma mère vaient fait que j'avais
attéri des jours et des nuits dans les bras de mon
père; alors une alchimie reptilienne s'était produite.
E
N
F I N le soir du Dytique
(1) arriva.
Ce
fut une journée comme
les autres (un mardi) car de toutes les façons le Dernier Jour
est un jour terriblement comme un autre. ELLE devait finir les
rideaux, LUI devait donner une ultime couche de peinture au fronton
des tentures, MOI finir mes leçons et tenter de guérir
mon Dytique qui se mourait dans l'eau froide du bidet de la petite
salle de bain. Ma passion pour les insectes faisait que j'y croyais
et que je réussirai à le faire nager comme AVANT.
Et;
donc ... à la vingt
et unième heure de l'horloge la machine à coudre
grondait encore, le bureau se remplissait du parfum de
thérébenthine et le petit enfant avait
désespérément entamé un dernier exercice
de respiration artificielle au coléoptère moribond.
PUIS
SOUDAIN, l'enfant se mit
à hurler: "ça y est! miracle, papa, il respire et il
recommence même à battre des
élytres!!!"
comme
aurait dit Zazie
"MIRACLE, MON CUL!!!!"
A
22h il ne nous restait plus
que 5
heures d' INNOCENCE sur
terre.
L'insecte
non plus, n'allait
pas vivre longtemps, c'était juste un dernier pied de nez, un
effet d'illusion, une RÉMISSION comme disent les
cancéreux, une remise de peine au coupable.
Ai-je
embrassé mon
père, ce soir là? Pourvu que je n'ai pas oublié?
Il paraît que les morts s'en foutent! Q U I
..
S A I T ?
JE
les entend encore crier tous
les deux dans la chambre des parents, séparée de la
mienne seulement par une cloison: " Maintenant il est tard tu dois
aller te coucher." Heureusement cette soirée fut calme, sans
colère ni dispute aucune. J'étais certain que
mère finirait par se plaire dans la nouvelle ville, certain
que je finirai par aimer ce damné lycée Descartes et
j'étais fier de mon père et je l'aimais comme seuls
savent aimer les fous.
FOU,
je le deviendrai en pleine
media noche.
J'
EMMERDE LA MORT qui vous
prend tout ce que vous aimez. Mais la pire des blessures que les
humains ont faîte à la Bête Immonde a
été l'ignorance. Mépriser à ce point ce
qui fait la condition même de l'homme (soumis au tragique de la
vie) m'a toujours semblé, depuis cette nuit sacrée, un
signe profond de décadence.
(1)
coléoptère aquatique
"Non
ne rentre pas" -
j'étais seul dans le vestibule avec mes larmes et ma peur
infinie à voir le médecin assis pornographiquement
à cheval sur mon père et lui enfonçer la
poitrine comme j'avais fait avec l'insecte. S A N S E S P O I R. Puis
l'horrible "Non, il n'y a plus rien à faire" fut
chuchoté par le médecin. Ma mère s'est
précipité sur moi emmitouflé dans ma robe de
chambre de ce terrible mois d'avril. Elle me serrait dans ses bras en
pleurant sans fin. Le médecin s'est installé sur la
table de la salle à manger puis a rédigé l'acte
de décès. LA VIE DE MON PERE ÉTAIT
DÉFINITIVEMENT TERMINÉE, puis il a lui-même
téléphoné à nos amis pour qu'ils viennent
nous "tenir compagnie". La mère et l'une des filles sont
venues sonner à notre porte à 2h30 du matin.
C'était la première fois de ma vie que j'entendais une
sonnette en pleine nuit, en pleine tempête, en plein orage au
centre des Enfers. Ceux qui nous avaient accueillis dans la ville
inconnue nous re-cueillaient dans leur beau château. La plus
grande des filles de la maison m'a re-couché dans un lit
Napoléon du salon, a essuyé mes larmes qui repoussaient
aussi sec, a ramené sur moi le drap en me couvrant de baisers,
espérant que le miracle puisse avoir une place dans ma pauvre
tête.
-
Seule la chienne de chasse
réussit vaguement à me consoler à force de me
coller comme si j'étais son nouveau maître. Elle devait
aimer le son de mes sanglots et le sel de mes larmes.
-
Au matin, mes joues
étaient trempées car la mort ça fait pisser le
bon dieu, et ces larmes, personne ne pourra jamais les essuyer. d'une
certaine façon métaphorique, je naissais à la
vie, le jour de la fête des Morts. Pourquoi ne nourons-nous pas
instantanément dans de pareilles situation; je n'en saurai
jamais rien. Il n'y eut pas de maladie, il n'y eut pas de suicide:
rien que des problèmes de transport du corps de mon papa, des
problèmes de cérémonie  des problèmes de déménagements , de parents de
ma mère, de chambres, de survie. Il y a comme un gigantesque
gouffre dans mes souvenirs. On me ramena du château bourgeois
à la résidence de la haute ville qui sentait le
plâtre et la boue pour voir le corps sortir du hall
d'entrée allongé sur un brancard d'infirmier et
recouvert d'une longue couverture grise et chaude. les deux
ambulanciers firent glisser la civière dans la DS blanche et
nous partîmes pour un voyage de 90 minutes de silence et de
larmes. Ce n'était pas par désir de mise en
scène macabre que tout cela se fit mais par
impossibilité économique et matérielle de faire
autrement. Pour nous comme pour Lui, il n'y avait plus que le retour
au pays natal. Dans l'autre ville, les parents attendaient le retour
de la dépouille de leur fils. Ma mère ne cessait de
répéter qu'il avait toujours dit qu'il voulait une
cérémonie sans fleur ni couronne, ni sans passer par
l'église. Au lieu de respecter sa parole on allait faire tout
l'inverse. Le supplice de la mère et de l'enfant allait durer
trois longs jours. Chapelle ardente dans la salle à manger
(avec nous à dormir à côté), visite des
journalistes pour les photos et les articles, messe des morts
interminable et enfin le deuxième voyage en voiture puis
à pied, jusqu'au tombeau. Trois cars de tourisme empli de
fervents syndicalistes sont bêtement venus nous tirer les
dernières larmes que nous avions encore la force de produire.
des problèmes de déménagements , de parents de
ma mère, de chambres, de survie. Il y a comme un gigantesque
gouffre dans mes souvenirs. On me ramena du château bourgeois
à la résidence de la haute ville qui sentait le
plâtre et la boue pour voir le corps sortir du hall
d'entrée allongé sur un brancard d'infirmier et
recouvert d'une longue couverture grise et chaude. les deux
ambulanciers firent glisser la civière dans la DS blanche et
nous partîmes pour un voyage de 90 minutes de silence et de
larmes. Ce n'était pas par désir de mise en
scène macabre que tout cela se fit mais par
impossibilité économique et matérielle de faire
autrement. Pour nous comme pour Lui, il n'y avait plus que le retour
au pays natal. Dans l'autre ville, les parents attendaient le retour
de la dépouille de leur fils. Ma mère ne cessait de
répéter qu'il avait toujours dit qu'il voulait une
cérémonie sans fleur ni couronne, ni sans passer par
l'église. Au lieu de respecter sa parole on allait faire tout
l'inverse. Le supplice de la mère et de l'enfant allait durer
trois longs jours. Chapelle ardente dans la salle à manger
(avec nous à dormir à côté), visite des
journalistes pour les photos et les articles, messe des morts
interminable et enfin le deuxième voyage en voiture puis
à pied, jusqu'au tombeau. Trois cars de tourisme empli de
fervents syndicalistes sont bêtement venus nous tirer les
dernières larmes que nous avions encore la force de produire.
Et
pour couronner le tout il
tombait des albardes sur la forêt de parapluies et sous le ciel
noir de fin des temps.
Le
cercueil s'est
enfoncé dans la terre à jamais (du moins c'est que l'on
me disait) jusqu'à ce jour de septembre 2003 lors des
funérailles de ma mère où j'en revis le
couvercle vermoulu. On vient de couper l'arbre entre la poubelle et
la tombe; malade, il était malade et fallait car une branche
aurait pu tomber et tuer quelqu'un. Mourir dans un cimetière:
une vraie mort blanche. La foule des faux amis convoqués pour
faire semblant, les larmes silencieuses des parents de mon
père devant la boite en bois de leur enfant et les cordes qui
tombaient sur la forêt de parapluies et les discours
panégyriques à n'en plus finir: c'était
horriblement caricatural.
Il
est vrai qu'à partir
de la seconde où nous avons franchi le seuil du portail du
jardin tranquille, laissant mon père, seul dans la nuit,
l'humidité et le vent glacial de ce printemps maudit, la vie
allait être un abattoir sanglant.
Cette
immonde
souffrance du trauma, je ne
pourrai plus la subvertir en plaisir que dans l'art fantastique: des
séries B de la Hammer aux angoisses métaphysiques de
Tarkovski en passant par la peinture d'Odilon Redon ou la
littérature d'E.Poê. J'ai toujours eu l'impression (car
ce n'est justement qu'un sentiment) que je devais ma survie au
cinématographe. A 15 ans je connaissais déjà
Bresson, Dreyer, Bergman, Hitchcock, Ford ou Fllini. Mon tuteur
m'offrit après mon premier appareil photo  (cétait une merveille car mon père m'avait appris
à respecter son appareil 6x6 à soufflet que je
vénérais tel un Dieu, tel un objet de désir) (la
camera oscura qui révélait la réalité
vue), une caméra 8m/m réservée aux grands. mon
premier film, une bobine de 10 minutes n'était que la partie
de pétanque mais je savais (à force d'avoir
regardé) déjà faire du touné-monté.
Alors je me jetais à la fois dans l'histoire de la double
invention du cinéma: les Frères Lumière et
Mélies vers lequel j'inclinais. seuls l les FX, la magie, l'
ILM et compagnie pourraient peut-être m'aider à remonter
du gouffre.
(cétait une merveille car mon père m'avait appris
à respecter son appareil 6x6 à soufflet que je
vénérais tel un Dieu, tel un objet de désir) (la
camera oscura qui révélait la réalité
vue), une caméra 8m/m réservée aux grands. mon
premier film, une bobine de 10 minutes n'était que la partie
de pétanque mais je savais (à force d'avoir
regardé) déjà faire du touné-monté.
Alors je me jetais à la fois dans l'histoire de la double
invention du cinéma: les Frères Lumière et
Mélies vers lequel j'inclinais. seuls l les FX, la magie, l'
ILM et compagnie pourraient peut-être m'aider à remonter
du gouffre.

 Si
vous avez lu cette page sans passer par les premiers mètres de
la descente RETOUR AU DEPART
Si
vous avez lu cette page sans passer par les premiers mètres de
la descente RETOUR AU DEPART .
.
Point
d'orgue
..........
F I N
...Malus:
lien
ultime... ©
Édition La Maison
Avril 2005
©
Édition La Maison
Avril 2005
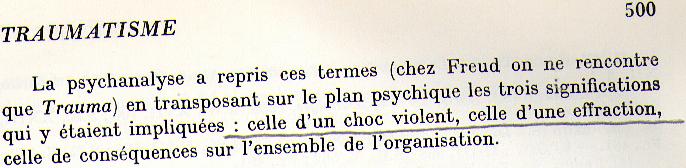
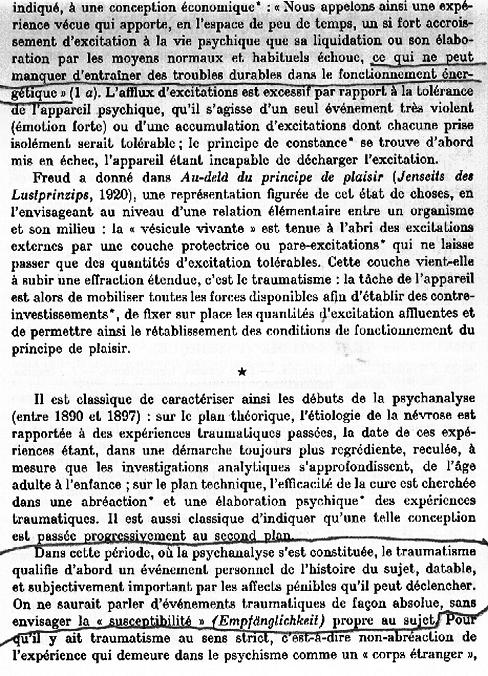 Trève
de
définition, j'ai quand-même tendance à penser
qu'il arrive à quasi tous (certains élus
échappent à la malédiction et coulent à
longueur de temps une vie douce) au moins un terrible accident qui
fait un trou dans la coque et force le navire à couler
jusqu'au fond.
Trève
de
définition, j'ai quand-même tendance à penser
qu'il arrive à quasi tous (certains élus
échappent à la malédiction et coulent à
longueur de temps une vie douce) au moins un terrible accident qui
fait un trou dans la coque et force le navire à couler
jusqu'au fond. 
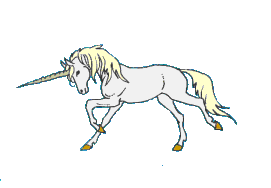

 .
.
 des problèmes de déménagements , de parents de
ma mère, de chambres, de survie. Il y a comme un gigantesque
gouffre dans mes souvenirs. On me ramena du château bourgeois
à la résidence de la haute ville qui sentait le
plâtre et la boue pour voir le corps sortir du hall
d'entrée allongé sur un brancard d'infirmier et
recouvert d'une longue couverture grise et chaude. les deux
ambulanciers firent glisser la civière dans la DS blanche et
nous partîmes pour un voyage de 90 minutes de silence et de
larmes. Ce n'était pas par désir de mise en
scène macabre que tout cela se fit mais par
impossibilité économique et matérielle de faire
autrement. Pour nous comme pour Lui, il n'y avait plus que le retour
au pays natal. Dans l'autre ville, les parents attendaient le retour
de la dépouille de leur fils. Ma mère ne cessait de
répéter qu'il avait toujours dit qu'il voulait une
cérémonie sans fleur ni couronne, ni sans passer par
l'église. Au lieu de respecter sa parole on allait faire tout
l'inverse. Le supplice de la mère et de l'enfant allait durer
trois longs jours. Chapelle ardente dans la salle à manger
(avec nous à dormir à côté), visite des
journalistes pour les photos et les articles, messe des morts
interminable et enfin le deuxième voyage en voiture puis
à pied, jusqu'au tombeau. Trois cars de tourisme empli de
fervents syndicalistes sont bêtement venus nous tirer les
dernières larmes que nous avions encore la force de produire.
des problèmes de déménagements , de parents de
ma mère, de chambres, de survie. Il y a comme un gigantesque
gouffre dans mes souvenirs. On me ramena du château bourgeois
à la résidence de la haute ville qui sentait le
plâtre et la boue pour voir le corps sortir du hall
d'entrée allongé sur un brancard d'infirmier et
recouvert d'une longue couverture grise et chaude. les deux
ambulanciers firent glisser la civière dans la DS blanche et
nous partîmes pour un voyage de 90 minutes de silence et de
larmes. Ce n'était pas par désir de mise en
scène macabre que tout cela se fit mais par
impossibilité économique et matérielle de faire
autrement. Pour nous comme pour Lui, il n'y avait plus que le retour
au pays natal. Dans l'autre ville, les parents attendaient le retour
de la dépouille de leur fils. Ma mère ne cessait de
répéter qu'il avait toujours dit qu'il voulait une
cérémonie sans fleur ni couronne, ni sans passer par
l'église. Au lieu de respecter sa parole on allait faire tout
l'inverse. Le supplice de la mère et de l'enfant allait durer
trois longs jours. Chapelle ardente dans la salle à manger
(avec nous à dormir à côté), visite des
journalistes pour les photos et les articles, messe des morts
interminable et enfin le deuxième voyage en voiture puis
à pied, jusqu'au tombeau. Trois cars de tourisme empli de
fervents syndicalistes sont bêtement venus nous tirer les
dernières larmes que nous avions encore la force de produire.
 (cétait une merveille car mon père m'avait appris
à respecter son appareil 6x6 à soufflet que je
vénérais tel un Dieu, tel un objet de désir) (la
camera oscura qui révélait la réalité
vue), une caméra 8m/m réservée aux grands. mon
premier film, une bobine de 10 minutes n'était que la partie
de pétanque mais je savais (à force d'avoir
regardé) déjà faire du touné-monté.
Alors je me jetais à la fois dans l'histoire de la double
invention du cinéma: les Frères Lumière et
Mélies vers lequel j'inclinais. seuls l les FX, la magie, l'
ILM et compagnie pourraient peut-être m'aider à remonter
du gouffre.
(cétait une merveille car mon père m'avait appris
à respecter son appareil 6x6 à soufflet que je
vénérais tel un Dieu, tel un objet de désir) (la
camera oscura qui révélait la réalité
vue), une caméra 8m/m réservée aux grands. mon
premier film, une bobine de 10 minutes n'était que la partie
de pétanque mais je savais (à force d'avoir
regardé) déjà faire du touné-monté.
Alors je me jetais à la fois dans l'histoire de la double
invention du cinéma: les Frères Lumière et
Mélies vers lequel j'inclinais. seuls l les FX, la magie, l'
ILM et compagnie pourraient peut-être m'aider à remonter
du gouffre. 

